|
Introduction
Où se situe la Nouvelle-Calédonie ?
Histoire de la Nouvelle-Calédonie
Les Kanak, premiers occupants de la
Nouvelle-Calédonie
L’arrivée de l’homme blanc
L'annexion de la Nouvelle-Calédonie
Utilisation de la Nouvelle-Calédonie pour le
bagne
L’après bagne
Les coutumes du peuple kanak
Les danses
Les masques
La faune et la flore spécifique à la Nouvelle-Calédonie
La faune
La flore
Conclusion
Glossaire
Bibliographie et remerciements
Bibliographie
Remerciements
Où se situe la Nouvelle-Calédonie ?
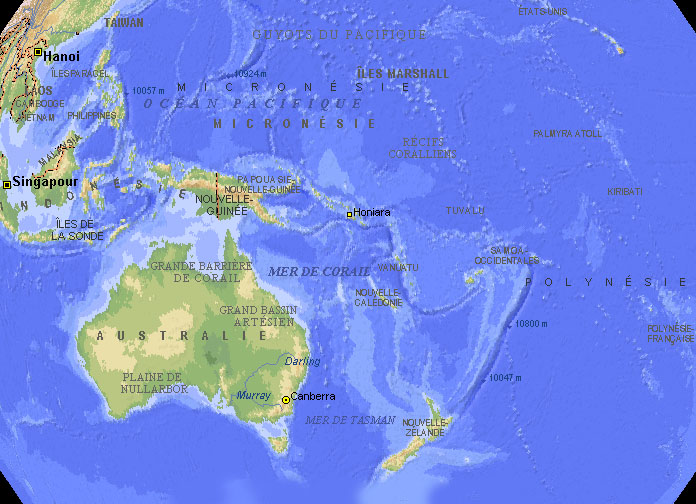
Introduction :
La Nouvelle-Calédonie va connaître cette année une
élection des plus importantes pour son avenir. En effet, les Calédoniens, Kanak ou
Caldoche, vont décider de leur indépendance ou non.
Afin de connaître comment cette île était perçue dans
notre entourage, nous avons procédé à un questionnaire sur un panel représentatif de
différentes générations au nombre de 20 personnes (âgées de 14 ans à 78 ans). Voici
les différentes questions posées :
Où se trouve la
Nouvelle-Calédonie ?
A cette question pourtant fort simple,
seule 50% des personnes interrogées ont su répondre correctement. Océan Pacifique près de
l’Australie 50%
Océan Pacifique
près du Pérou 10%
Océan Indien 40%
Quel événement majeur de
cette fin de siècle va marquer prochainement la Nouvelle-Calédonie ?
A cette question, les réponses ont
été : Un vote
autonomiste 5%
Je ne sais pas 85%
Un événement
sportif 10%
Comment vous imaginez-vous
un habitant de la Nouvelle-Calédonie ?
A cette question, les réponses ont été :
Un noir comme
Karembeu (footballeur) 40%
Un polynésien comme
Téritéu (véliplanchiste) 40%
Un blanc comme
Lafleur 20%
Devant cette méconnaissance de ce Territoire français,
il nous a semblé intéressant d’expliquer l’histoire tourmentée de cette île,
afin de mieux comprendre ce qui va se dérouler.
Nous raconterons dans ces grandes lignes l’histoire
du territoire, puis nous irons à la rencontre des coutumes canaques. Enfin, afin de voir
la Nouvelle-Calédonie comme une entité unique, nous nous intéresserons à sa faune et
à sa flore.
Les Kanak, premiers occupants de la Nouvelle-Calédonie :
Il y a trois mille cinq cents ans environ, les Kanak,
Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, s'installent sur la Grande Terre et aux îles
Loyauté.
Leur présence, ancienne dans l'archipel, alors encore inoccupé, est attestée par des
poteries caractéristiques de toutes les premières implantations océaniennes.
Les Kanak apportent dans leurs pirogues des plantes comestibles originaires d'Asie:
ignames, taros, cannes à sucre, arbres à pain, cocotiers et quantité d'autres
végétaux utiles.
Leur technique d'horticulture par brûlis fait alors reculer la forêt primaire au
profit d'une savane arbustive. En se dispersant le long du littoral puis en remontant dans
les vallées, les Kanak (comme d'une manière générale tous les peuples de Mélanésie)
se sont organisés en petites communautés, aucune ne prenant le pas sur les autres. Pour
ouvrir de nouvelles surfaces fertiles, ils élaborent une agriculture hydraulique en
terrasses dont on trouve peu d'équivalents aussi sophistiqués dans le Pacifique. En
outre, aux îles Loyauté, des sociétés sensiblement différentes de celles de la Grande
Terre se sont constitués.
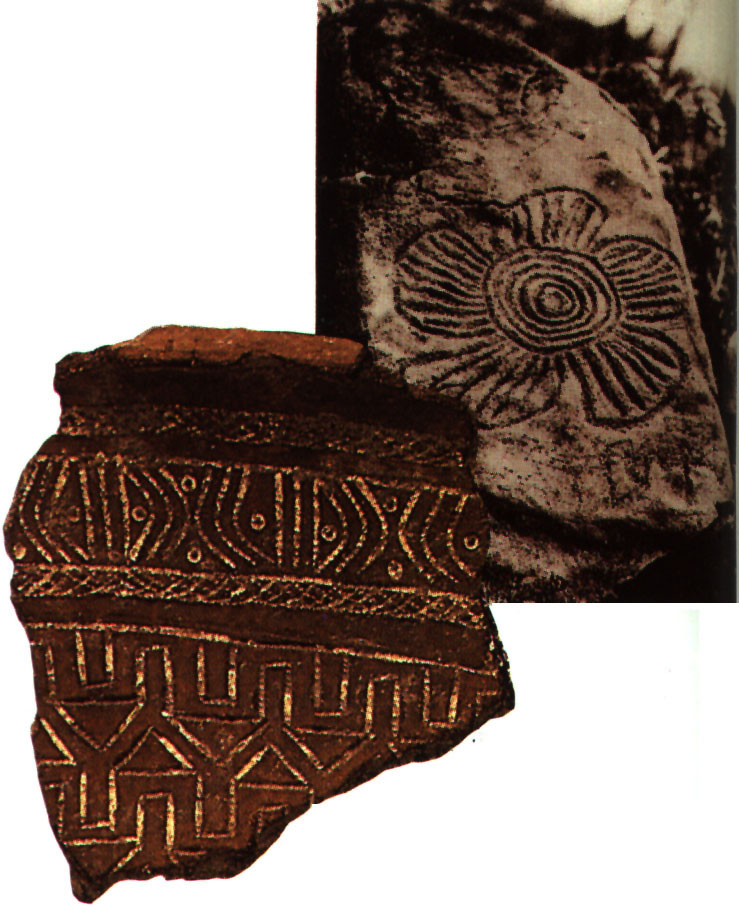
De très nombreux témoignages montrent qu'ainsi la civilisation kanak a développé
dans tous les domaines, à partir d'une souche unique, des particularismes marqués :
invention d'un nouveau genre de poterie et de plusieurs styles de sculpture, gravures dans
la pierre de dessins énigmatiques (pétroglyphes), peintures rupestres, créations
d'institutions politiques et matrimoniales distinctes.

De même, les langues vraisemblablement peu nombreuses des tout premiers arrivants se
diversifièrent sur place. Quelques millénaires plus tard, au XIXème siècle,
on découvrait en Nouvelle-Calédonie un éventail linguistique de trente-deux langues,
aussi large et varié que celui de l’Europe entière. Vingt-huit d'entre elles (dont
une langue polynésienne) sont encore parlées aujourd’hui.
Les conflits se réglaient par les armes, et
les guerres étaient le prélude à de nouvelles relations contractuelles, mais la
violence, surtout lorsqu'elle s’exerçait sur des groupes éloignés, pouvait prendre
un tour plus radicale. Jusqu'au massacre des ennemis, dont on mangeait les dépouilles.
Non pas, principalement, par manque de nourriture carnée : comme dans toute la
Mélanésie faire disparaître les corps privait les vaincus des cérémonies de deuil qui
font des morts des ancêtres protecteurs.
L’arrivée de l’homme blanc :
Dans le sillage de Bougainville et des trois voyages de Cook, de
nombreuses expéditions à caractère scientifique cingleront à travers l'océan
Pacifique. Source de rêve, de mélancolie et d'utopie pour tant d'artistes et de
voyageurs, l'Océanie attire et fascine aussi ceux qui voient dans les archipels du Grand
Océan des exutoires possibles aux problèmes de l'Europe industrielle naissante Les
paysans, pauvres et les chevaliers de l'industrie et du commerce iront en Océanie
chercher aventure et fortune; les missionnaires répondront à la déchristianisation de
l'Ancien Monde par la conquête aux antipodes de nouvelles âmes; les militaires du second
Empire prolongeront par des guerres aussi faciles que lointaines leurs espoirs
d'avancement et de médailles; les politiciens, enfin, construiront des empires coloniaux
qui exaltent le prestige des nations d'Europe et servent de lieux d'exil pour tous les
indésirables.
L'annexion de la Nouvelle-Calédonie :

La concurrence entre Anglais et Français activa l'expansion
européenne dans le Pacifique. Cette querelle géostratégique prit le tour d'une guerre
de religion. Catholiques et protestants, exaltés par l'idée d'amener à Dieu les
derniers sauvages, se disputaient à Tahiti, aux îles Marquises, en Nouvelle-Zélande le
monopole de l’évangélisation des Océaniens.
L'annexion de la Nouvelle-Calédonie en 1843 fut ainsi le résultat de la conjonction
des intérêts bien compris de l’Eglise et du second Empire. Mais, pour des raisons
diplomatiques, ce n’est que 10 ans plus tard, le 24 Septembre 1853, que
Febvrier-Despointes, sur les ordres de Napoléon III s’empare officiellement de la
Nouvelle-Calédonie où ce dernier compte créer une colonie pénitentiaire à
l’instar des Anglais en Australie.
Utilisation de la Nouvelle-Calédonie pour le
bagne :
Au XIXème siècle, la politique calédonienne de la
France est commandée par les exigences du bagne. Les injonctions ministérielles
adressées aux fonctionnaires d'outre-mer sont claires: " La Nouvelle-Calédonie
est avant tout une colonie pénitentiaire. [...] Vous ne devez pas perdre de vue que
l'œuvre principale qui s'impose à votre administration est celle de la
Transportation. "

On appelle " transportés " les criminels
qu'une cour d'assises a condamnés aux travaux forcés. La loi de 1854 prévoit qu'ils
seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres
d'utilité publique. Mais, en cas de bonne conduite, autorisation peut leur être donnée
de travailler pour les habitants de la colonie ou les administrations locales. Les
condamnés peuvent aussi recevoir des concessions de terrain à cultiver pour leur propre
compte. Après leur peine, ces fermes deviendront leur propriété. La France espère
ainsi jouer sur deux tableaux :
- punir les justiciables,
- étendre son emprise sur la Nouvelle-Calédonie par un peuplement européen.

Signe de la misère qui sévit en Europe, en plus de trente ans,
de 1864 à 1897, quelque soixante-dix convois acheminent de France plus de vingt mille
forçats jusqu'aux pénitenciers de Nouméa (île Nou), de l’île des Pins ou de la
cote ouest.
Les premiers forçats sont d'abord cantonnés à l'île Nou en face du port de Nouméa,
où ils construisent les bâtiments de leur enfermement et un hôpital. Trois ans plus
tard, au vu des premiers résultats, la transportation vers la Nouvelle-Calédonie
s'organise. La population pénale passe de 967 (en 1867) à 9997 en 1885.
Des forçats propriétaires et honnêtement
mariés :
Divisés en quatre classes, les transportés sont employés dans
des ateliers, pour la construction de routes ou autres travaux d’intérêt général.
Grâce à leur bonne conduite, d’autres obtiennent des concessions agricoles.
Dans le même temps le gouvernement prône l'envoi en Nouvelle-Calédonie de femmes
enfermées dans les prisons centrales de métropole. Un décret d’août 1878 et une
décision ministérielle de janvier 1882 précisent les conditions de mise en concession
de terres au profit de condamnés, ceux-ci se voient également offrir la possibilité de
se marier s’ils trouvent l’âme soeur parmi les nouvelles venues.
C’est ainsi que cinq cents prisonnières célibataires françaises acceptèrent
d'aller épouser là-bas des condamnés. D’autres virent leurs épouses et leurs
enfants autorisés à les y rejoindre.
Ainsi, plus des trois quarts des ménages qui se forment alors en Nouvelle-Calédonie
comprennent au moins un conjoint d'origine pénale. Un demi millier d'enfants naissent sur
les concessions, huit cents arrivent de France pour retrouver leurs parents, tandis que,
des unions entre libérés du bagne et femmes mélanésiennes, sont issus quantité de
petits métis incorporés tantôt au monde européen, tantôt à la communauté kanak.
L'administration pénitentiaire devient le plus gros propriétaire foncier de
Nouvelle-Calédonie,
d'abord limité à l’île Nou, le domaine de l'administration pénitentiaire
déborde rapidement de son site d'origine L'administration s’empare de terres encore
disponibles et achète des terrains à des particuliers. En 1842, elle contrôle 31700
hectares et 110000 en 1895 ! La quasi totalité des terres fertiles est entre ses
mains.
Mais, désirant tout faire, tout régenter et produire de tout, les dirigeants du bagne
entreprennent trop de tâches diverses, sans rigueur ni ténacité. Au lieu de se limiter
aux cultures coloniales traditionnelles en ces lieux et souvent de bon rapport, telles que
café, tabac, vanille, etc..., ils s’engagent dans des essais et des expériences
aléatoires. Ce qui aboutit inévitablement à un échec des cultures, dans un premier
temps, en Nouvelle-Calédonie.
Les tribunaux répriment la Commune condamnent
à la déportation en Nouvelle-Calédonie des milliers d'hommes et de femmes :
Après la semaine sanglante de mai 1871 qui fit plus de trente
mille victimes parmi les Communards tués les armes à la main ou fusillés sans jugement
les conseils de guerre siègent sans discontinuer pendant des mois. Au printemps 1872, ils
peuvent utiliser la loi sur la déportation votée le 13 mars.
" -Article2 : la presqu’île de Ducos dans la Nouvelle-Calédonie
est déclarée lieu de déportation dans une enceinte fortifiée
- Article 3 : l'île des Pins et en cas d'insuffisance l’île de Maré,
dépendances de la Nouvelle-Calédonie sont déclarées lieux de déportation simple pour
l'exécution de l'article 17 du code pénal.
- Article 4 : les condamnés dans une enceinte fortifiée jouiront dans la
presqu'île de Ducos de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la
garde de leur personne et le maintien de l'ordre. Ils seront soumis à un régime de
police et de surveillance déterminé par un règlement d'administration publique qui sera
rendu dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi. Ce
règlement fixera les conditions sous lesquelles les déportés seront autorisés à
circuler dans tout ou partie de la presqu'île, suivant leur nombre, et à s'y occuper de
travaux de culture, ou d'industrie, et à y former des établissements provisoires par
groupe ou par famille.
- Article 5: les condamnés à la déportation simple jouiront dans l'île des Pins, et
dans l'île de Maré, d'une liberté qui n'aura pour limite que les précautions
indispensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le bon
ordre. "
De mai 1872 à octobre 1878, vingt-deux navires débarquent en Nouvelle-Calédonie
quatre mille deux cent quarante-trois déportés, tous pour faits liés à la Commune,
sauf quatre-vingt-dix condamnés arabes exilés pour avoir participé à la grande
insurrection kabyle de 1871. Parmi les proscrits, quelques hautes figures de la Commune
tels Louise Michel, Henri Rochefort, Charles Jourde, Jean Allemane...
La grande révolte canaque :

Par ironie de l'Histoire, les révoltés de la Commune ont à
affronter une autre révolte, celle de la grande insurrection canaque de 1878. Un
mouvement qui couve depuis longtemps face aux autorités de la Nouvelle-Calédonie
dépouillant régulièrement les tribus canaques de leurs terres et de leurs villages.
Les chefs Morai, Atai, Baptiste, Pois ont été fusillés ou décapites et Areki,
Moindou et bien d’autres sont captifs prés de notre territoire avec tous les
survivants de leurs tribus Leurs terres confisquées vont servir à l’établissement
de nouveaux colons s’il s’en trouve encore pour se risquer dans la brousse.
L’apaisement s’est fait mais dans la mort.
Derniers convois pour la
Nouvelle-Calédonie :
Les Communards ne sont qu'un intermède dans l’usage pénal
que l’on fait de la Nouvelle-Calédonie. Leur rapatriement ne laisse plus dans
l’île que des droits-communs, les transportés pour travaux forcés. En 1887,
apparaît une nouvelle catégorie de condamnés : les relégués. Petits délinquants
multirécidivistes dont la France de la IIIème république décide, par une
loi de l885, de se débarrasser. Considérés comme la lie des malfaiteurs, ils sont
parqués à l’île des Pins à la grande indignation des colons libres, las de voir
leur île servir de dépotoir à la métropole. Ils soutiennent le gouverneur Feillet qui
réclame la fermeture du " robinet d'eau sale ".
L'archipel ne remplit pas son rôle de terre
de grande punition :
Les gouvernants parisiens mettent fin à l’expérience
néo-calédonienne. L'éventualité d'un exil aux antipodes n'effraie nullement ceux qui
transgressent les lois. Malgré l’existence de cellules, de châtiments corporels,
d'exécutions capitales, le travail à l'air libre est plus attractif que les prisons
centrales de la métropole. On sait le climat sain, les possibilités de trafic
importantes et celles d'évasion évidentes (même si le chiffre de belles réussies
atteint à peine sept cents cas sur plus de quinze mille condamnés).
Puisque l'archipel du Pacifique ne fait plus peur, on rouvre la route de Cayenne
(Là-bas au moins les taux de mortalité sont conséquents).
En 1897 tout nouvel envoi vers Nouméa est définitivement arrêté. A charge pour ceux
qui s'y trouvent d'y finir leurs jours.
En 1898, l'île compte douze mille sept cent trente deux habitants d’origine
pénale soit la moitié de la population blanche et le quart de la population totale. Une
partie d'entre eux fit souche et nombreuses sont les familles d'aujourd'hui en
Nouvelle-Calédonie qui peuvent revendiquer un ancêtre bagnard.
L’après bagne :
Une nouvelle vague de colons: les planteurs de
café :
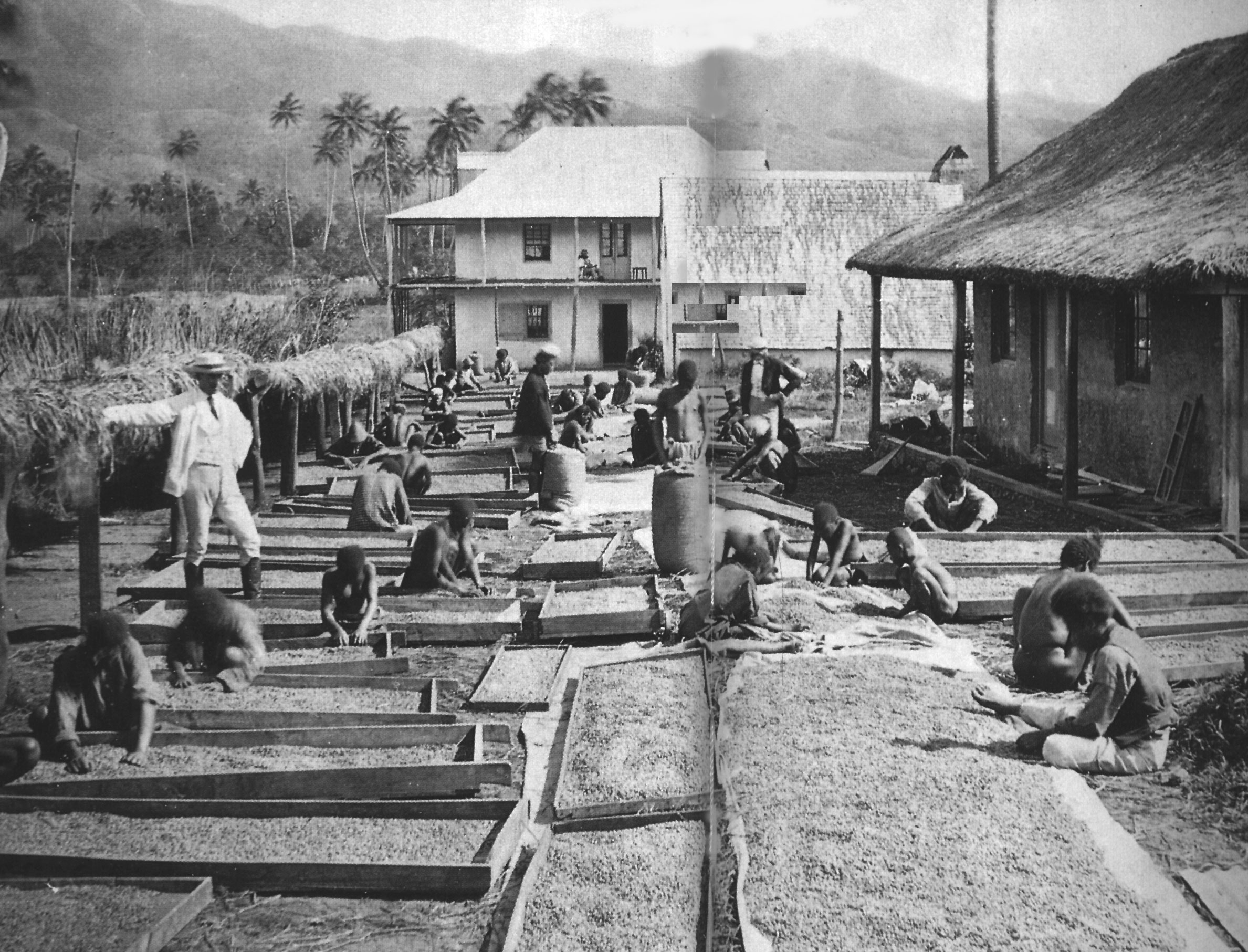
A partir de 1894, le gouverneur Feillet veut redresser la
situation. Il introduit, à grands renforts de publicité, une centaine de familles
d'agriculteurs français, principalement dans les vallées de la côte Est (côte la plus
fertile). A charge pour eux de cultiver du café afin de développer le pays.
Quelques-uns de ces nouveaux pionniers, dont les terres proviennent des dernières
réquisitions brutales du patrimoine foncier kanak, vont s'accrocher avec énergie à
leurs hectares. Leurs descendants sont aujourd'hui très fiers de leurs vaillants
ancêtres. Ces derniers durent improviser dans tous les domaines: relations avec les
Mélanésiens, construction de leur maison, nouvelles cultures.
Ils en appelèrent à l'administration qui les avait lancés dans cette aventure. En
vain. Finalement difficultés et déceptions auront raison d'un bon nombre de ces colons
Feillet.
La fièvre minière :

La mine, plus que l’agriculture, a peuplé la
Nouvelle-Calédonie. Des 1854, James Paddon avait signalé du charbon au sud-ouest de la
Grande Terre. La fièvre de l’or, repéré dans le nord de l’île, n'épargne
pas non plus le pays, tandis qu'on y découvre du cuivre, du plomb argentifère, du zinc,
du fer, du cobalt, du chrome et surtout, révélée en 1863par l'ingénieur Jules Garnier,
la présence de grandes quantités de nickel.
Les premières mines sont ouvertes au mont Dore en 1874, à Thio en 1875. Une usine de
traitement du minerai est bâtie à Nouméa en 1879. L’année suivante naît la
Société Le Nicket (SLN) qui préside, jusqu'à nos jours, aux destinées de la
Nouvelle-Calédonie.
L'importation de main-d'œuvre :
Sur les mines, sur les grandes propriétés, les colonisateurs
français choisissent, dès les années 1860, d'employer une main-d'oeuvre à bon marché,
des travailleurs émigrés sont recrutés dans d'autre territoires ou colonies :
Indiens de La Réunion, Néo-Hébridais et, quelques décennies plus tard, Japonais,
Indochinois, Javanais des Indes néerlandaises. Cette politique économique, qui se tourne
aussi vers des blancs démunis (ouvriers libres ou bagnards) mais dont la population kanak
locale est écartée, exerce sur des gens déracinés une autorité absolue. Plusieurs
milliers d'indochinois viendront travailler et mourir pour la Société Le Nickel dans les
mines de Thio et des alentours de Nouméa. De véritables négriers capturent, dans leurs
îles, des Néo-Hébridais qui périront sur la grande Terre sous le joug d'une
exploitation forcenée.
Cette traite a permis l'essor du secteur minier et avec le secours de la
main-d'œuvre pénale, l'aménagement routier et portuaire, longtemps très rustique,
de l’île. Liés aux employeurs blancs qui les ont importés sous contrat et
enfermés dans des ghettos installés sur les mines mêmes, les trieurs exotiques
(c’est ainsi qu’on les appelait à l’époque) resteront pour la plupart
étrangers aux Kanak, quant à eux tout aussi enfermés dans leurs réserves et totalement
interdits d'expression.

De 1854 à 1914, la Nouvelle-Calédonie voit s'accroître sa
population non kanak. Le recensement de 1906 fait apparaître que les Mélanésiens, dont
le nombre est inférieur à trente mille, ont perdu en cinquante ans plus de la moitié de
leurs effectifs d'origine, tandis que les Européens et les autres ethnies installées en
Nouvelle-Calédonie totalisent au bas mot vingt cinq mille personnes.
A cet afflux correspond le développement de Nouméa. Dans l'intérieur de l'île
hormis quelques bourgades comme Bourail , Népoui et Pouembout ou Thio (au pied de la mine
de nickel). L’essentiel du peuplement se disperse dans des fermes installées sur des
domaines plus ou moins vastes.
Cette expansion urbaine et rurale de la colonie prive peu à peu les Kanak de leurs
terres, presque sans compensation.
Pourtant, à ses débuts, l’administration coloniale avait reconnu les droits
fonciers des autochtones. Le jour de la prise de possession, le capitaine de vaisseau
Tardy de Montravel avait déclaré aux populations kanak de
Balade :" Voulez-vous être français ? Désirez-vous que votre pays
soit soumis à la domination française ? Nous vous protégerons, vos terres seront
toujours à vous, on ne vous prendra que ce qui ne vous est pas nécessaires "
De même, dans une déclaration de janvier 1855, le gouvernement s'engageait à
" racheter les terres occupées par les indigènes ".
Ces belles promesses ne seront pas tenues. Le plus souvent, le colonisateur, pour
dégager les espaces jugés nécessaires à son installation, ne procéda à aucune
transaction. Il se contenta d'entériner au besoin par des arrêtés, les accaparements
anarchiques de terres ou, pire encore, de les faciliter en élaborant une juridiction
aussi spéciale qu'hypocrite. Des fonctionnaires consciencieux ont très tôt compris que,
chez les Kanak, l'accès aux terres est réglementé par la propriété individuelle
privée, transmise à l'intérieur de la famille ou à défaut du clan.
En bonne logique, il aurait donc fallu négocier les transactions foncières avec
chaque ayant droit. On préféra ressusciter le mythe bien colonial d'une propriété
collective primitive placée sous
l’autorité d'un chef promu personnellement responsable de toute la tribu. Il
suffira alors de circonvenir ou de menacer ce personnage pour avoir accès à tout un
territoire au risque de provoquer la fureur des propriétaires mélanésiens.
Il n’est pas étonnant que dans les trois premières décennies de la
colonisation, plus de vingt révoltes éclatèrent. Aux casse-tête, haches, frondes et
sagaies des autochtones, l’armée oppose son artillerie, ses fusils et exploite les
rivalités entre Kanak.
Le problème Kanak persiste jusqu’à la seconde Guerre Mondiale où la guerre du
Pacifique porta à la société calédonienne un premier coup. En 1942 débarquent sur une
Nouvelle-Calédonie ankylosée plus de cent mille soldats américains soit plus de deux
fois la population de l'archipel. Ils apportent leur matériel ultramoderne, leurs
dollars, leur formidable esprit d'entreprise et d'innovation.
Le choc moral n'est pas moins grand, les Mélanésiens remarquent que des officiers
noirs commandent de simples soldats blancs. Les Américains donnent l'exemple d'un
dynamisme qui ne semble pas s'embarrasser de préjuges sociaux et raciaux.
Quelques années plus tard, la vieille société coloniale se trouve encore placée au
cour de changements qui la contestent en 1946, un décret gouvernemental abolit le code de
l’indigénat et la nouvelle constitution donne la citoyenneté française aux
Mélanésiens comme à toutes les autres ethnies non européennes. Formellement une
colonie française devient Territoire d'Outre-Mer. Mais, dans la pratique, les pesanteurs
du système antérieur freineront les évolutions soudain rendues possibles. Héritage
colonial contre démocratie; la Nouvelle-Calédonie n'est pas, aujourd'hui encore, sortie
de cette contradiction.
Dans l’après-guerre, l’accès au droit de vote et à la libre association
pour tous offre, pour la première fois aux communautés du Territoire, les conditions
d'une compétition politique ouverte. Un peu plus tard, en 1956, la Loi-Cadre, dite loi
Defferre, entend faire participer directement toutes les ethnies, et en particulier les
Mélanésiens, à la gestion des affaires locales. Ceux qui, dans la situation politique
antérieure, s'estimaient bafoués, exploités ou laissés pour compte vont
s’engouffrer dans cette brèche. Ils se heurteront aux plus fervents défenseurs du
modèle colonial.
Au début des années cinquante, broussards ouvriers et Kanak se regroupent dans le
premier parti d’opposition : l'Union Calédonienne (U.C.). Cette formation reste
fermement contrôlée par les églises protestante et catholique qui invitent les
mécontents à avancer des revendications respectant l’ordre établi. U.C. n'en
formulera pas moins un programme réclamant pour les Kanak la possibilité d'accéder au
statut de fonctionnaire, l'égalité des salaires, la construction d'écoles et de
dispensaires. Les progrès sociaux escomptés doivent selon l’Union Calédonienne
établir une juste parité entre Noirs et Blancs et restaurer la dignité du peuple
mélanésien.
Mais les traditions ségrégationnistes tenaces de la société calédonienne auront
raison de ces aspirations.
La République coloniale (1963-1981) :
Quand l’Union Calédonienne remporte à partir de 1953
plusieurs élections et s'affirme comme un parti pouvant diriger la politique locale, les
conservateurs du Territoire recourent à l’illégalité (opérations de commandos
contre des élus, attentats, etc...) pour rester au pouvoir. Le gouvernement laissera
faire. Abandonnant toute idée d'autonomie interne et de décolonisation, il juge alors
que les nouveaux intérêts de la France dans le Pacifique Sud doivent l'inciter à
conserver coûte que coûte la Nouvelle-Calédonie sous sa tutelle directe.
Au moment même où en 1963 la Polynésie française devient un site
d'expérimentations nucléaires, les lois Jacquinot suppriment les dispositions libérales
de la Loi-Cadre puis, en 1969, les lois Billotte assurent à la métropole un ferme
contrôle des mines calédoniennes.
Cette reprise en main renoue avec la tradition autoritaire d'antan, qu'une formidable
montée des cours du nickel vient encore conforter.
Entre 1969 et 1972, la flambée des prix du minerai vert suscite une euphorie
économique sans précédent. Les villas, les hôtels, les bateaux de plaisance
fleurissent alors dans Nouméa, devenue en quelques années une petite capitale aux
charmes californiens. Mais une fois de plus, les Mélanésiens ne sont pas conviés à
prendre parti au festin. Bien au contraire la remise en selle de la bourgeoisie
nouméenne, l'afflux d'argent et la relance du peuplement blanc prennent à revers les
évolutions que l’Union Calédonienne avait impulsées et appelés de ses voeux.
Ce retour de bâton accroît les tensions et déclenche l’essor d'un nationalisme
kanak qui va ouvertement contester la présence française.
Le réveil mélanésien :

Inspirés par les luttes du Tiers monde et la contestation
étudiante en Europe, les tout premiers bacheliers kanak dénoncent par des gestes
spectaculaires, à partir de 1969, la marginalisation économique et le racisme qui
frappent leur communauté. Dans la foulée apparaissent de nouveaux partis politiques
(principalement le Parti de Libération Kanak, PALIKA; le Front Uni de Libération Kanak,
F. U. L. K.; l'Union Progressiste Mélanésienne, U.P.M., etc...) qui appelle les
colonisés et exploités de Nouvelle-Calédonie à lutter contre l’affairisme et,
bientôt, pour la première fois à soutenir le principe d'une indépendance du peuple
kanak.
La soif de justice des Mélanésiens liera désormais indissolublement revendication de
souveraineté et revendication foncière.
La radicalisation :
En 1977, lasse d'être privée de l’outil institutionnel
(l’autonomie interne) qui permettrait peut-être de combattre les iniquités criantes
du Territoire, l'Union Calédonienne rejoint les tenants de l’indépendance kanak. La
plupart des Européens membres de l’U.C. s’inquiètent de ce changement
d'attitude et se tournent vers le R.P.C.R. (Rassemblement pour la Calédonie dans la
République) branche locale du R.P.R. de métropole. S'y regroupent pêle-mêle tous ceux
qui s'opposent à l’émergence d'un pouvoir mélanésien respecté. La bipolarité
politique de la Nouvelle-Calédonie creuse ainsi un fossé entre deux blocs
historiques : celui des autochtones et celui des gens venus d’ailleurs.
1981-1984 : l'échec de la troisième
voie :
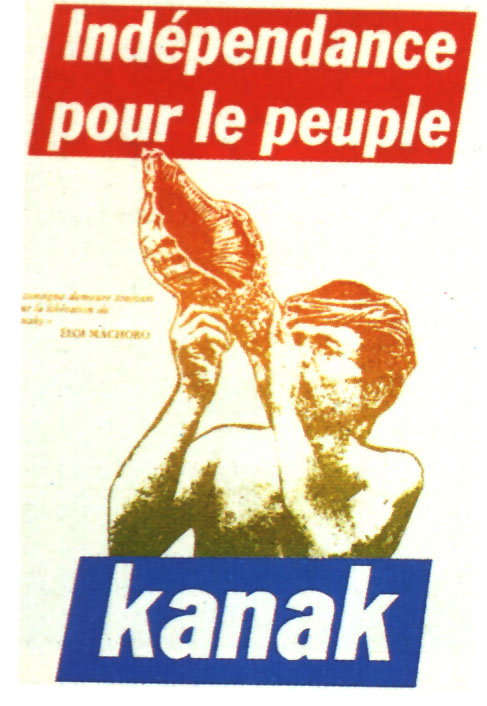
En 1981,l’arrivée de la gauche au pouvoir annonce les
espérances des indépendantistes et, du même coup irrite ceux qui souhaitent une
reconduction pure et simple de la situation du Territoire. Seuls quelques élus
calédoniens plus modérés et convaincus que les Mélanésiens ont un rôle d'avenir à
jouer dans la transformation du pays, permettent à une nouvelle majorité de se
dégager : leur parti la F.N.S.C (Fédération pour une Nouvelle Société
Calédonienne) s'allie au Front Indépendantiste (FI] constitué en 1979 et assume avec
lui deux années durant les responsabilités du pouvoir local. La gauche peut ainsi
renouer avec la tradition réformiste de la quatrième République. Elle instaure un
impôt sur le revenu en 1982, réduit les indexations de salaires des fonctionnaires et
s’efforce d’insérer l’intérieur de l’archipel dans l’économie
globale de la Nouvelle-Calédonie. Mais cette recherche d’une voie moyenne n’est
pas adaptée aux affrontements politiques, voire aux violences présente sur le
Territoire.
En 1984, des élections sont prévues pour renouveler l’Assemblée territoriale.
Piégés par le principe démocratique un homme une voix, les Kanak ne peuvent escompter
que 30% des suffrages. L’accès à l'indépendance par le verdict des urnes leur est
barré à moins qu’on ne limite le corps électoral non mélanésien aux seuls
immigrés de longue date ayant au minimum un parent né sur le Territoire. Le ministre des
DOM-TOM repoussa dans un nouveau projet de statut, cette exigence des indépendantistes
qui excédés créent le Front de Libération National Kanak Socialiste (F.L.N.K.S.) en
août 1984 et appellent au boycottage actif du scrutin prévu pour le 18 novembre 84.
Ce jour-là, les militants du F.L.N.K.S. s’opposent par la force au déroulement
du vote. Dans les semaines suivantes,les terres des colons sont occupées, leurs maisons
brûlées, leurs armes confisquées. Les Européens anti-indépendantistes par la voie du
R.P.C.R. demandent à l’Etat de rétablir l’ordre et de défendre les
institutions territoriales. Le gouvernement voulant éviter une confrontation meurtrière
avec une population mélanésienne dont comprend la mauvaise humeur désarme les
gendarmeries.
Désespèrés de se sentir abandonnés de nombreux colons se
réfugient à Nouméa. Mais à Hienghène, une dizaine d'entre eux, le 5 décembre 1984,
assassinent dix militants du F.L.N.K.S. dans des conditions atroces. De nombreux incidents
éclatent (attentats, meurtres, affrontements). De nouvelles élections réinstallent
temporairement la paix. Mais le retour de la droite au pouvoir (avec Jacques Chirac comme
Premier ministre) va mettre fin à cette paix précaire.

" Si les Kanak bougent, nous leur serrerons le
kiki " annonce Bernard Pons le 26 mai 1986 au début de son mandat de ministre
des DOM-TOM. De plus, il décide le quadrillage militaire des villages kanaks et met fin
au rééquilibrage économique amorcé par ses prédécesseurs. Des terres promises aux
Kanak sont réattribuées à des colons. Ces mesures provocatrices prises à
l’encontre du F.L.N.K.S. déclencheront la tragédie de la grottes d’Ouvéa le
22 avril 1988 où six gendarmes et dix-neuf Kanak furent massacrés...

La réélection de François Mitterrand et le retour de la gauche au pouvoir vont
tempérer ces inquiétudes Pour renouer le dialogue le gouvernement sait s’appuyer
sur les forces morales qui restent puissantes en Nouvelle-Calédonie. Profitant du climat
d'incertitude et d’angoisse qui prévaut encore dans l’île, le gouvernement
parvient à convaincre les deux leaders du F.L.N.K.S. et du R.P.C.R. (Tjibaou et Lafleur)
de trouver un compromis qui entérine les rapports de force du moment et inaugure un
processus évolutif de transformation sociale et politique. Le 26 juin 1988 sont signés
les accords de Matignon qui découpent le Territoire en trois provinces dont deux seront
administrées par les indépendantistes (la province Nord et la province des îles
Loyauté). Ces accords prévoient également un référendum sur la question de
l’indépendance en 1998, mais n’auront droit de voter que ceux inscrit sur les
listes avant 1988 (ce qui rééquilibre les forces politiques en présence).
Les danses :

Différentes régions des danses traditionnelles
Les textes des premiers visiteurs et des missionnaires
constituent les plus anciennes sources écrites sur la danse et la musique kanak. Les
danses décrites, exécutées dans un contexte social large, sont très importantes pour
la vie culturelle, elles ont survécu à l'époque où la politique menée par
l'administration coloniale et par les églises allait à l'encontre de la tradition kanak.
En revanche, les danses mentionnées dans ces écrits et exécutées en groupes restreints
(cercles privés) n'existent plus de nos jours. Ces danses maintenant perdues sont
regroupées dans la classe des danses intérieures.
Les danses intérieures :
Ces danses étaient exécutées à l'intérieur des cases
(maisons traditionnelles en bois, écorce et paille). Dansées spontanément et presque
quotidiennement, elles ne demandaient pas une grande préparation. Les hommes dansaient
seuls dans leur case et les femmes dans la leur.
Dans son livre Mœurs et superstitions des néo-calédoniens, le Père
Lambert décrit une danse qui était exécutée pour permettre aux membres d'une
communauté d'offrir à une personne sans ressource des présents et des vivres. Cette
personne pouvait ainsi payer les ouvriers qui l'avaient aidée à construire, par exemple,
une grande case ou une pirogue. Le Père Lambert appelle cette danse le ouïa.
Une deuxième danse intérieure, décrite elle aussi par le Père Lambert, appelée
tsianda, était accompagnée de chants et du son d'un bambou creux (sorte d'idiophone). Le
tsianda était en fait un jeu pour échanger individuellement des objets. Un homme pose,
en dansant, l'objet qu'il souhaite échanger au milieu de la case. Une seconde personne,
en dansant, elle aussi, va chercher l'objet et le remplace par un autre objet.
Les danses extérieures :
Ce sont les danses qui ont survécu. Elle se déroule lors du
pilou (terme signifiant danses en mélanésien). On compte trois types de danses
extérieures :
Le discours sur perche :

Quand l'animateur et le crieur ont préparé l'auditoire pour la
harangue (discours solennel), l'orateur monte sur une perche (une grande branche plantée
dans la terre). L'orateur énumère les clans alliés ou raconte l'origine du clan. Après
le discours sur la perche, en tant que représentant de son lignage, il offre rituellement
des vivres. Chaque groupe participant à lacérémonie et offrant des vivres était
obligé d'envoyer un orateur pour proposer un discours.
Pendant la dernière phase, l'orateur ainsi perché est entouré par des hommes de son
groupe social, ceux-ci peuvent porter des casse-tête et des sagaies. Ces hommes regardent
l'orateur et encouragent son discours par des chuintements et des sifflements. Les hommes
dansent sur place à pas glissants, avant et arrière, symbolisant ainsi le déroulement
des événements racontés dans le discours.
Bien qu'aujourd'hui ces discours soient plus rarement pratiqués lors des fêtes
sociales, la structure du discours n'a pas changé, les pas des danseurs non plus. C'est
en référence à ces pas que ce discours peut être classifié comme une danse.
La danse en rond :
La danse commence le soir, après que les " Maîtres du
Pilou " eurent rappelé la signification de la perche, autour de laquelle la
danse va se former. La perche symbolise la relation entre les Kanak et leurs ancêtres,
protagonistes de leurs mythes. Ce symbole de vie ne représente pas seulement le centre
matériel du cercle formé par la foule, mais aussi le centre spirituel. Pour cette
raison, on nomme cette perche "le corps de danse". Le boria (qui veut dire danse
en rond en mélanésien) est la danse des dieux, des "esprits", des défunts.
Cette sorte de danse, ne peut avoir lieu que la nuit et il n'est pas permis d'allumer
un feu pour éclairer la scène. Les danseurs, la corps barbouillés de noir, munis de
banderoles, de sagaies et de casse-tête, se mettent dans la peau de ces personnages
mythiques. Les danseurs forment un cercle et trottent autour de la perche en pas libres
tout en suivant le rythme des percussions.
Pour cette danse, l'orchestre s’installe au milieu des danseurs, juste à côté
de la perche. Des chants traditionnels kanaks (à deux voix) sont au cœur de cette
musique. Les danseurs soutiennent la musique avec des cris, des chuintements et des
sifflements. La musique jouée par l'orchestre dans cette danse est partout la même sur
la Grande Terre.
Aujourd'hui, cette danse est pratiquée de la même façon, lors de fêtes sociales
dans les tribus (mariages, inaugurations, etc.) ou lors de festivals culturels. Tous les
spectateurs peuvent participer à cette danse; lorsqu'il s'agit d'un grand événement, on
peut observer plusieurs centaines de danseurs.
Les danses imitatives :
Les danses imitatives sont les plus remarquables dans l'éventail
des danses kanak. Elles se distinguent des autres par l'étendue de leurs formes et de
leurs expressions, elles ont une signification importante pour le groupe d'origine.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle de danses kanak, on pense généralement aux danses
imitatives. Les jeunes du "clan utérin" reçoivent de la part des jeunes du
groupe paternel, une invitation à danser à travers l'envoi d'un "bouquet
d'herbes". Un "Maître de danse" (le responsable de la danse) dirige les
jeunes hommes, par des cris, il annonce les actions suivantes: ..."Une foulée vers
l'ouest".. "Sautez", etc... Après la présentation de cette danse, les
bouquets d’herbes sont déposés aux pieds du groupe paternel et avec le discours
d'un membre, l'événement de la danse est officiellement clos.
Les danses imitatives d'aujourd'hui présentent de nombreuses similitudes avec celles
qui ont été décrites par les premiers colons non seulement dans leur présentation,
mais aussi dans leur fonction de propriété culturelle, fonction pour laquelle elles sont
soumises aux règles coutumières.
Aujourd'hui, une danse imitative appartient au groupe qui l'a créée. Dans le groupe,
il y a une ou plusieurs personnes responsables de cette danse. Cela peut être une
personne qui a reçu la danse dans un rêve et qui l'enseigne au groupe de danseurs ou,
s'il s'agit d'une danse transmise de génération en génération, une personne, souvent
un des fils, qui assume cette responsabilité pour l'intérêt qu'il porte à la danse. Si
ce n'est pas le responsable qui l'enseigne lui-même aux jeunes danseurs qu’il
surveille cependant les répétitions.
Les masques kanaks :
La découverte du masque :
Le premier masque de Nouvelle-Calédonie connu en Europe fut
acquis par Labillardière, naturaliste à la recherche de La Pérouse, dans la région de
Balade en 1792, contre deux ciseaux de menuisier. Il s’agit d’une figure de
masque en bois.
L’aire de répartition des masques :
Le masque, en tant qu’objet destiné à occulter le visage,
a probablement existé autrefois en de nombreux points de Nouvelle-Calédonie, ne
serait-ce que sous la forme de jeux d’enfants. C’est par exemple le cas à
Houaïlou où les enfants se confectionnent des masques avec les feuilles de bambou ou de
cocotier. Ces masques peuvent être peints avec des terres de couleur.
Les données que nous avons sur le masque, en tant que réalisation intégrée à des
pratiques sociales, autres que les jeux d’enfants, indiquent qu’il était
autrefois présent dans le nord, le centre et dans une partie du sud de la Grande Terre.
Sous la forme de masque à figure de bois sculptée et manteau de plumes, il paraît avoir
été inconnu à l’extrême sud de la Grande Terre et aux îles Loyauté.
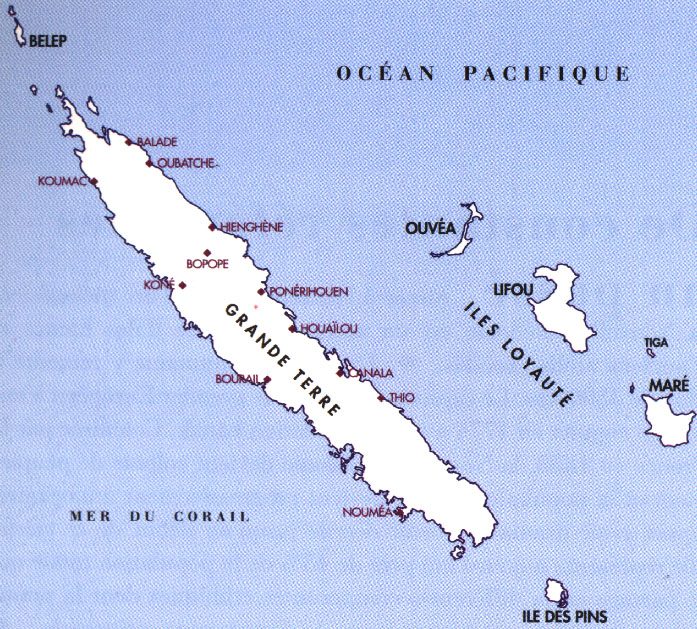
Carte des principales villes ayant des masques
Le masque :
Le masque kanak était un déguisement que l’on enfile et
qui occulte le corps de son porteur pour ne laisser visible que les bras et les jambes. Il
est composé de trois parties : la figure, la coiffure et le manteau.
La figure :
Pièce de bois sculptée, représentant un visage humain,
taillée d’une seule pièce, d’environ 60 cm de haut et 40 cm de large, la
figure comporte sur son pourtour des trous qui permettent l’accrochage de la coiffure
et du couvre-nuque d’une part, de la barbe et du manteau, d’autre part. Le  visage visible ne représente qu’une partie de
la pièce (10 à 30 cm). L’intérieur de la pièce est creusé afin d’en
alléger le poids et de s’ajuster au visage du porteur. Les yeux ne sont jamais
évidés, le porteur du masque regardant par l’ouverture de la bouche. Dans aucun des
cas la langue n’est figurée. Le visage se termine par une barbe faite de tresses de
cheveux humains, mêlés à des fibres végétales, pouvant atteindre 60 cm de long. visage visible ne représente qu’une partie de
la pièce (10 à 30 cm). L’intérieur de la pièce est creusé afin d’en
alléger le poids et de s’ajuster au visage du porteur. Les yeux ne sont jamais
évidés, le porteur du masque regardant par l’ouverture de la bouche. Dans aucun des
cas la langue n’est figurée. Le visage se termine par une barbe faite de tresses de
cheveux humains, mêlés à des fibres végétales, pouvant atteindre 60 cm de long.
Le couvre-nuque rigide est fait de tiges fines tenues par des fibres de bourao (sorte
d’hibiscus). Cette armure légère est noircie au noir de bancoul (charbon de bois du
bancoulier).
Les essences de bois utilisés diffèrent selon les régions. Au sud, on utilise plus
volontiers un bois léger et facile à travailler (le doi), et dans le nord, on
privilégie les bois en fonction de leurs critère symbolique (bois utilisé par le
chef,etc...) qui sont en général durs et denses (donc difficiles à travailler).
Le port du masque :
Nous ne possédons que très peu de données sur le port du
masque. Pendant les cérémonies de fin de deuil d’un chef ou d’un autre membre
important de la tribu, le masque courait en montant et en descendant de chaque coté des
présents cérémoniels amassés sur l’allée centrale. Il menaçait les maternels et
poursuivait et frappait indifféremment adultes et enfants.
L’origine du masque :
Suivant la voie ouverte par Codrington de la possibilité
d’une liaison entre les masques du Vanuatu et ceux de Nouvelle-Calédonie, McKesson a
proposé récemment (1990), comme origine possible des masques kanak le Vanuatu.
Hypothèse étayée par les comparaisons des poteries de ces deux îles.
 
 
La faune :
Cette faune endémique à la Nouvelle-Calédonie est très
pauvre. En effet, les espèces qui ont survécues à la chasse intensives des premiers
habitants puis à celle des bagnards français sont peu nombreuses.
Cette faune se constitue actuellement de membres de la famille des oiseaux , de la
famille des reptiles et de la famille des mammifères. En effet, la famille des poissons
ne contient pas d’espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie.
Les oiseaux :
La première espèce, symbole du territoire de la
Nouvelle-Calédonie, est le cagou. Le Cagou est le seul représentant de la famille des
Rhynochétidés et est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Il fréquente les forêts
humides d’altitude et du littoral.
 Le Cagou est inapte au vol. C'est un insectivore qui se nourrit
principalement de larves et d'escargots. La taille des cagous varie entre 50 et 60 cm. Son
envergure moyenne est de 80 cm.
Le Cagou est inapte au vol. C'est un insectivore qui se nourrit
principalement de larves et d'escargots. La taille des cagous varie entre 50 et 60 cm. Son
envergure moyenne est de 80 cm.
Le mâle et la femelle sont identiques. Les jeunes sont de couleur brune avec des
stries sombres sur le dos.
Le cagou fait un nid à même le sol avec des branchages et des feuilles sèches. C'est
un nid très sommaire. La période de nidification s'étend de septembre à décembre. La
femelle pond un seul oeuf de 6 à 7 cm de longueur.
Le mâle et la femelle se partagent la tâche de l'incubation et du nourrissage des
petits. Le cagou, devenu rare et maintenant intégralement protégé, se signale dans la
forêt par son chant ressemblant à un aboiement.
Il est souvent présenté en photographie sous des attitudes agressives : huppe
dressé, plumes gonflées... Celles-ci sont surtout observables sur des éléments
captifs. Dans la forêt, le cagou, de nature craintive, adopte une attitude plus conforme
à son tempérament.
La seconde espèce est un gros pigeon, appelé notou (carcophage géant de son vrai
nom). Le notou est visible dans toutes les forêts de la Grande Terre. C'est le plus gros
pigeon de la Nouvelle-Calédonie, il est endémique.
C'est un frugivore et un granivore qui se déplace principalement par couple. On peut
s'étonner que, malgré son endémisme, il ne soit qu'insuffisamment protégé.
Le mâle et la femelle sont identiques et mesurent environ 50 cm. Les notous nichent
entre août et décembre. Le couple construit une plate-forme de brindilles variant entre
8 et 15 cm d'épaisseur et de 30 à 40 cm de diamètre. Les nids sont le plus souvent
implantés en haut des arbres.
La femelle pond un œuf (rarement deux) qui peut atteindre 5 cm de longueur et 3 cm
de diamètre. Les deux parents assurent l'incubation et le nourrissage des jeunes.
Les reptiles :
La faune erpétologique locale ne possède aucune espèce en
commun avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cinq éléments seulement se retrouvent
en Mélanésie et dans la plupart des archipels polynésiens.
La répartition se présente ainsi: 6 Rhacodactylus (geckos géants), 2 Euridactylus, 7
Lygosoma, 1 Typhlops qui sont endémiques à la Grande Terre. On doit y ajouter 2 Bavaya
et 1 lepidodactylus, endémiques aux îles Loyauté.
La faune des reptiles néo-calédoniens comprend en tout 30 espèces dont 28 Sauriens
et 2 Ophidiens.
Parmi les Ophidiens, le python des îles Loyauté (Enygrus bibroni), de la famille des
boïdés, se rencontre dans la plupart des îles polynésiennes. Il ne réside qu'aux
îles Loyauté, il y aurait été introduit par les premiers Polynésiens ayant débarqué
dans ces îles et qui le transportaient sur leurs pirogues comme nourriture vivante.
Une autre espèce est endémique à la Nouvelle-Calédonie, c’est le tricot rayé.
Petit serpent de 40 cm environ puisant sa nourriture dans le lagon mais vivant
principalement sur terre. Ce serpent est venimeux, et très dangereux, en effet, une
morsure peut tuer un homme en moins de 35 secondes. Aucune antidote n’existant, la
mort est certaine. Mais le tricot rayé étant de nature très craintive, les incidents
avec l’homme sont très rares, le dernier incident datant de plus de 20 ans.
Le Typhlops, longtemps considéré comme très rare, se trouve en fait assez couramment
sur la Grande Terre mais sa ressemblance avec un ver de terre ne souligne guère sa
présence. Il a d'ailleurs un mode de vie très souterrain.
Les Sauriens sont beaucoup plus courants et bon nombre de lygosoma, petits lézards
gracieux, aussi nommés margouilla, filent dans l'herbe des jardins et des savanes
herbacées.
Les Rhacodactylus ou geckos géants peuvent atteindre 35 cm de longueur. Il habitent
presque exclusivement les parties les plus sombres des forêts vallicoles mésophiles. Ils
se déplacent très lentement, sont malhabiles et absolument dépourvus de moyens
défensif.
Ils ne doivent leur survie qu’à leur don de mimétisme et à leurs mœurs
nocturnes qui leur permettent d'échapper aux rapaces. Durant la journée, ils se
réfugient sous les pierres ou dans les anfractuosités des rochers.
Les mammifères :
Avant l’arrivée des Européens, les seuls mammifères qui
peuplaient la Nouvelle-Calédonie étaient des Chiroptères et des Rongeurs.
Lors de son passage, Cook fit cadeau au chef Tea Bouma d’un couple de chiens et
quelques jours après d'un couple de cochons. Nul ne connaît exactement le sort qui leur
fut réservé, mais les visiteurs suivants n'en retrouvèrent point sur les lieux. Il
rencontrèrent par contre des cochons sur l’îlot Balabio.
Ce sont les missionnaires qui débarquèrent les premières chèvres. On retrouve un
chien dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie lors de l'attaque de la mission de
Balade en 1847. Il sera tué par des indigènes tandis qu'il défendait son maître.
Les premiers bovins furent introduit par Paddon en 1853, à l’île Nou. Bien que
l'on n'ait aucune preuve formelle, on peut supposer que Paddon introduisit aussi des
chèvres et des moutons.
Le premier couple de cerfs fut introduit par l’ingénieur Boutan en 1921. Les
cerfs proliférèrent très vite, à tel point qu'en 1921 il faudra organiser des battues
pour enrayer les dégâts qu'ils produisent dans les cultures.
L'introduction des premiers chats n'a pas laissé de traces historiques, elle a dû
cependant se produire très tôt, les navires emportant de nombreux chats à bord pour
lutter contre les rats inévitablement embarqués.
Cependant, une espèce endémique reste de nos jours encore présente.
Les roussettes appartiennent à l'ordre des Chiroptères. Du fait de leurs moeurs
noturnes, ces animaux sont restés mystérieux pendant très longtemps. Plusieurs de leurs
secrets sont maintenant percés.
On a recensé en Nouvelle-Calédonie 5 espèces de mégachiroptères (Roussettes) dont
les plus communes sont: Pteropus Tonganus (Roussette Noire), Pteropus aneanetinus
(Roussette Rousse) et Pteropus macmillani (Roussette des Grottes). Cette dernière espèce
est endémique à la Nouvelle-Calédonie. On trouve aussi quelques Microchiroptères
(chauves-souris), essentiellement dans les grottes, donc à proximité des massifs
karstiques (Lindéralique, Koumac, Adio ...) ou encore en forêt de basse et moyenne
altitudes où ils nichent dans des trous, ou dans des troncs d'arbres creux.
Les roussettes de Nouvelle-Calédonie sont frugivores, elles ne consomment en fait que
le jus des fruits et en dédaignent la pulpe. Leur langue creuse le fruit et prend la
forme d’un tube pour en aspirer le nectar. Leurs besoins alimentaires sont très
important car elles sont dotées d’une digestion très rapide (30 minutes environ).
La flore :
Les premiers botanistes qui visitèrent la Nouvelle-Calédonie
sont les allemands J.R. Forster et son fils qui, accompagnant Cook lors de son deuxième
voyage dans le Pacifique (1774), séjournèrent avec lui une dizaine de jours dans la
région de Balade et herborisèrent sur l’îlot Amédée, entre la Grande Terre et
l’île des Pins.
En 1794, La Billardière, parti avec Entrecasteaux à la recherche de La Pérouse et de
ses compagnons, faisait à son tour aux envions de Balade de fructueuses récoltes. C'est
lui qui publia le premier ouvrage important sur la flore néo-calédonienne (1824-l825).
Les nombreuses études consacrées à la flore néo-calédonienne par des chercheurs de
différents pays offrent certaines garanties d'objectivité, en particulier en ce qui
concerne l’examen des liens de parenté entre les espèces locales et celles qui sont
représentées dans les territoires voisins.
Caractères généraux de la flore
néo-calédonienne :
La flore de la Nouvelle-Calédonie est une flore
particulièrement riche, compte tenu des dimensions du Territoire (19105 km²). Plus de
3000 espèces indigènes de végétaux supérieurs ont jusqu'à présent été
inventoriées, dont environ 250 Cryptogames vasculaires (fougères et végétaux
apparentés) et 2.750 Phanérogames. Les Phanérogames se répartissent entre quelque 68O
genres se rattachant à 156 familles.

Cinq petites familles sont particulières à la Nouvelle-Calédonie : les
Amborellacées (1 espèce), les Oncothécacées (1 espèce), les Paracryphiacées (1
espèce), les Phellinéacées ( 10 espèces), les Strasburgériacées (1 espèce); mais
l'originalité de la flore réside surtout dans l'importance exceptionnelle qu'y
présentent certains groupes plus vastes et plus ou moins largement représentés
ailleurs.

Ce sont en premier lieu les Gymnospermes, les plus anciennes des
Phanérogames, la Calédonie, avec 15 genres, dont 3 endémiques, et 44 espèces, étant
dans le monde le territoire où ce groupe est le plus diversifié. Ainsi, 13 variétés de
pins colonnaires , sur les 19 espèces connues, sont calédoniennes.
 Ce sont ensuite les Cunoniacées, avec 6 genres, dont 2
endémiques, et 80 espèces, et les Myrtacées, avec une vingtaine de genres, dont 5
endémiques, et plus de 200 espèces, éléments fondamentaux des paysages calédoniens,
autant par l'abondance des individus que par la beauté de leurs fleurs.
Ce sont ensuite les Cunoniacées, avec 6 genres, dont 2
endémiques, et 80 espèces, et les Myrtacées, avec une vingtaine de genres, dont 5
endémiques, et plus de 200 espèces, éléments fondamentaux des paysages calédoniens,
autant par l'abondance des individus que par la beauté de leurs fleurs.

Mentionnons encore les Araliacées (10 genres, dont 6
endémiques, et une centaine d'espèces), les Epacridacées (2 genres, 18 espèces), les
Wintéracées, Dicotylédones primitives (4 genres, dont 2 endémiques,et 30 espèces),
les Protéacées (8 genres, dont 4 endémiques, et 42 espèces), les Palmiers (17 genres
endémiques sur quelque 220 connus dans le monde, et une trentaine d'espèces). Les
orchidées sont nombreuses (191 espèces), mais surtout remarquables par leurs formes
terrestres .
Pour toutes ces familles, les orchidées mises à part, l'endémisme spécifique est
très voisin de 100%, mais l'étude approfondie de bien d'autres groupes, moins
représentatifs peut-être, a fait apparaître chez eux des traits révélateurs d'une
évolution qui n'a pu s'accomplir qu'au cours d'une longue période d'isolement
biologique.
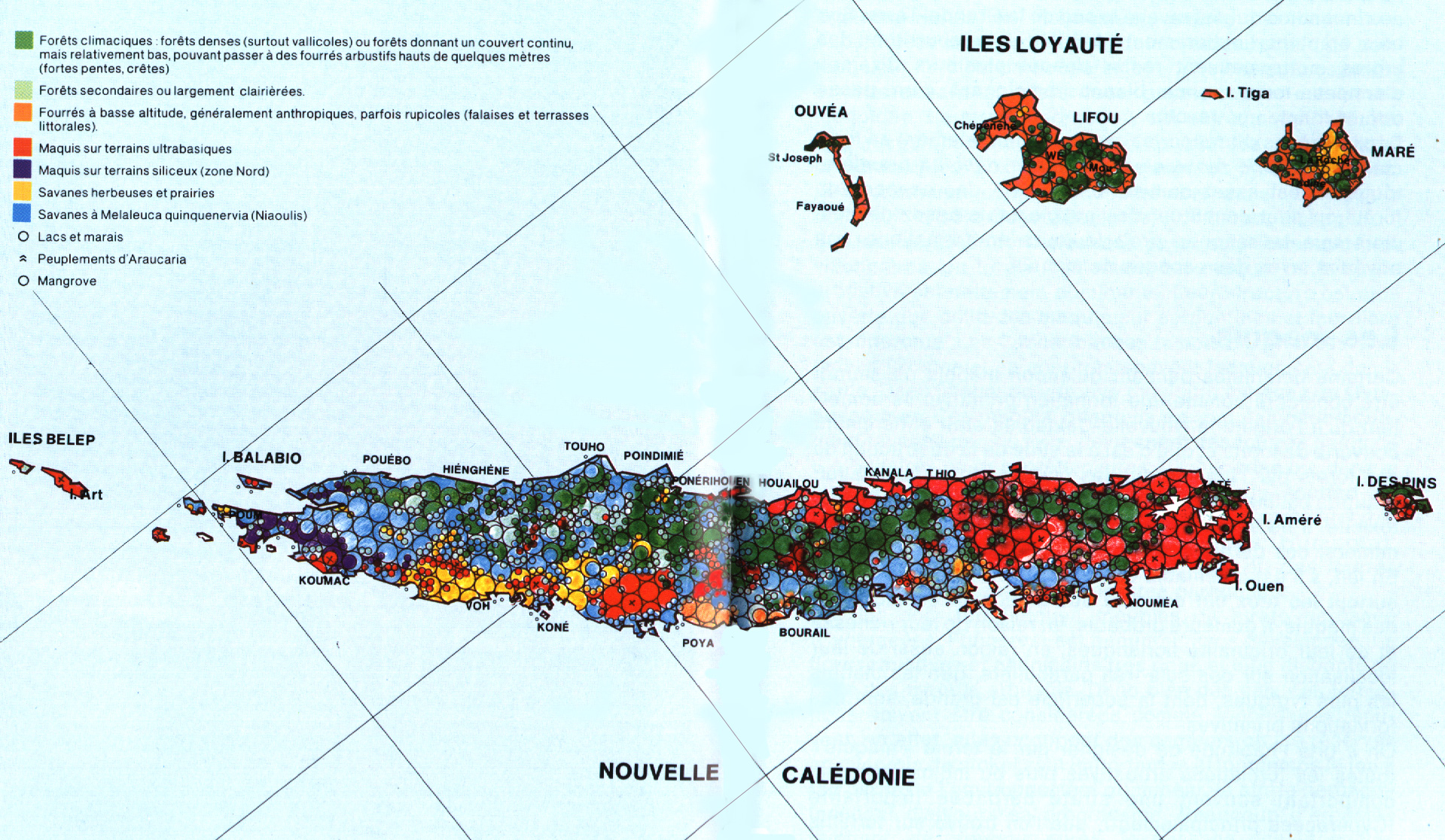
Références :
Alban BENSA
Nouvelle-Calédonie, un paradis dans la tourmente
Edition DECOUVERTES GALLIMARD
Septembre 1990-Evreux (France)
p12 à 127
Michel PIERRE
Le dernier exil, histoire des bagnes et forçats
Edition DECOUVERTES GALLIMARD
Octobre 1989-Evreux (France)
p76 à 85
Raymond AMMANN
Les danses Kanak, une introduction
Edition Agence de Développement de la Culture Kanak (A.D.C.K.)
Juillet 1994-Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
p8 à 67
Emmanuel KASARHEROU
Le masque kanak
Collection arts témoins
Editions Parenthèses/A.D.C.K.
Septembre 1993-Marseille (France)
p7 à 67
Maurice SCHMID
Fleurs et plantes de Nouvelle-Calédonie
Les Editions du Pacifique
1992-Singapour
p4 à 182
L’encyclopédie de la Nouvelle Calédonie
Tome de la faune
1971-Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
p143 à 236
Cartes fournies par Microsoft Encarta’97
Remerciements :
Nous remercions les personnes et les organismes suivants pour
leur collaboration :
Mme Bourhis , professeur à Népoui (Nouvelle-Calédonie),
L’A.D.C.K . pour ses documents,
L’office du tourisme néo-calédonien (Paris)
France3 pour son documentaire,
La 5ème pour son documentaire.
Un remerciement particulier aux personnes ayant accepté de répondre au petit
questionnaire. |
 |